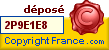-
Par eva-maïa le 21 Septembre 2023 à 18:30
"Blanqui et Maurras, deux parmi les nombreux détenus politiques - ou "droits communs" pour raisons politiques - qui donnent une dimension particulière à Clairvaux. Egrenons la litanie : des insoumis de la Grande Armée, 80 opposants de la Monarchie de Juillet, des journalistes des années 1850, beaucoup de communards, le prince anarchiste Pierre Kropotkine en 1883, le duc d'Orléans venu faire son service militaire bien que banni, des pauvres soldats mutinés de Verdun, en 1919 André Marty le mutin de la Mer Noire, entre 1940 et 1944 des résistants dont vingt et un d'entre eux fusillés par les nazis, Guy Mocquet l'auteur de la lettre lue aux écoliers, plusieurs ministres de Vichy à la Libération, les amiraux Esteva et Laborde, trois des quatre généraux du "quarteron" putschiste d'Alger, et enfin des indépendantistes de tous horizons..."
Jean-François LEROUX-DHUYS (in Clairvaux le génie d'un lieu)
 7 commentaires
7 commentaires
-
Par eva-maïa le 18 Juillet 2016 à 08:01
La première singularité de Fontevraud, c'est ce monastère double, qui accueillait les hommes et les femmes. En 1101 Robert d'Arbrissel se fixe avec ses disciples dans le "Vallon de la Fontaine d'Evraud" pour y bâtir l'abbaye de Fontevraud. Selon lui, chacun peut accéder au salut pourvu qu'il y mette du sien. Cela valait aussi pour les femmes réputées comme "moins dignes". Il promeut non seulement une femme alors considérée inférieure à l'homme, mais une femme non vierge jugée inférieure à une femme vierge. C'est ainsi qu'en 1115 il nomme Pétronille de Chemillé 1ère abbesse de l'ordre de Fontevraud...
Les gisants d’Aliénor d’Aquitaine, de son 2ème mari Henri II Plantagenêt, de leur fils Richard Cœur de Lion, et d'Isabelle d'Angoulême (épouse de Jean sans Terre) sont exposés dans l'église abbatiale, rappelant le glorieux passé de l'Abbaye Royale de Fontevraud.
Enfin, jouxtant le réfectoire, et tout près du puits profond, les cuisines romanes constituent la bizarrerie de l’Abbaye Royale, avec leur style byzantin. Le bâtiment diffère des autres par son parement typiquement poitevin, fait de pierres de Charente. La forme octogonale de ce bâtiment et sa toiture hérissée de nombreuses cheminées en « écailles de poisson » ont été un sujet de réflexion pour les historiens. Les «cuisines » de l’Abbaye Royale auraient en réalité été un fumoir, où étaient préparés le gibier et le poisson (essentiellement du saumon, alors abondant en Loire), aliment principal des religieuses. Du saumon fumé de Fontevraud, voici à quoi pouvait ressembler le repas de ces femmes vivant dans l’ascèse !
 17 commentaires
17 commentaires
-
Par eva-maïa le 13 Juillet 2013 à 00:03

Cette peinture murale originale du XIIe siècle, d'une surface d'environ 25m², (déposée selon la méthode "a strappo" qui consiste à détacher uniquement la couche picturale) était initialement située sur la voûte de la nef de l'église abbatiale. Elle a été apposée, après restauration, pour des raisons de conservation, dans le réfectoire de l'abbaye.
Il s'agit d'une peinture majeure du cycle d'Abraham. La scène relate l'expédition de représailles que le patriache va mener contre les quatre rois de Mésopotamie (Kedor-Leomer, Tidéal, Amraphel et Aryok) venus dévaster le pays de Sodome et ayant capturé Lot, son neveu, qui y résidait.
Abraham, à la tête d'un groupe de fantassins, met en fuite l'armée de cavaliers qui avaient capturé Lot, son neveu. Abraham et son armée, situés à gauche de la peinture, s'opposent à l'armée des rois, à droite. La multitude se traduit par une accumulation de corps d'hommes ou de chevaux entiers au premier plan, relayée par un amoncellement de têtes dessinées au dessus.
Les fantassins portent leur lance sur l'épaule. Abraham est représenté avec une barbe. Le sol est constitué de bandes de traits parallèles de deux couleurs (ocre jaune et ocre rouge).

Ci-dessus le réfectoire aux neuf travées couvertes de voûtes d'ogives séparées par de larges doubleaux.
C'est la prestigieuse abbaye de Saint-Savin qui a été choisie comme le lieu idéal d'implantation du Centre international d'art mural.

Bâtiments conventuels et chevet de l'église abbatiale.

Au sud se dresse l'ancien logis de l'abbé, dont les fondations pourraient être médiévales, mais qui a été repris de fond en comble au XVIIe siècle ; avant d'etre restauré pour abriter l'administration du Centre International d'art mural.

Vue de l'ensemble depuis les bords de la Gartempe.

Pont Vieux sur la Gartempe...
(photo eva juin 2013)
 4 commentaires
4 commentaires
-
Par eva-maïa le 11 Juillet 2013 à 18:57

Dès l'origine, les colonnes de la nef ont certainement reçu un décor en faux marbre de couleurs diverses. Mais celui qu'on leur voit aujourd'hui procède d'une part, d'une malheureuse initiative du curé Dubois, et d'autre part, d'un ponçage en règle que Mérimée leur fit subir pour effacer les traces de cet excessif rajeunissement. Dans une lettre de 1844, l'Inspecteur général se disait satisfait du résultat :
"Les colonnes astiquées ont pris une teinte admirable, écrivait-il, et quand on aura achevé de les bouchonner, elles pourront mystifier les antiquaires les plus durs à cuire."
Les deux piles de la troisième travée sont en outre ornées sur leur face Est d'un bestiaire. Un seul est authentique, l'autre (celui qui est photographié ici) ayant été exécuté au milieu du XIXe siècle pour fournir un pendant au premier. L'homme médiéval n'attendait pas de ces bestiaires une leçon de zoologie ; mais ce genre d'ouvrage lui permettait de lier une image christologique à chaque représentation d'animal, déjà porteuse d'une signification symbolique. Ainsi l'image du lion offrait-elle l'intérêt de pouvoir être lue selon un schéma à deux niveaux : à la fois comme un animal dormant les yeux ouverts et comme une image du Christ, dont la nature divine était restée vivante tandis que, durant son séjour au tombeau, sa nature humaine endurait la mort. (source : Yves-Jean Riou, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France)

Transept

Dans le choeur, le décor des chapiteaux des colonnes, dont les corbeilles sont alternativement garnies de trois rangs de feuilles d'acanthe selon une inspiration corinthienne, ou tapissées de lionnes dressées par couple, offre de grandes similitudes avec celui des chapiteaux du choeur de la collégiale Sainte-Radegonde de Poitiers.


Chapelle d'axe : la scène d'ensevelissement peinte sur la partie supérieure se rapporte peut être à la vie d'un saint, soit Hermenegilde, martyr espagnol du VIe siècle auquel est dédié l'autel, soit Marin, martyr de Maurienne du VIIIe siècle dont les restes, à l'origine conservés dans la crypte placée sous cette chapelle, auraient été donnés à l'abbaye par Charlemagne.

décor peint en frise dans le transept...



(à suivre)
 3 commentaires
3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Boire la lumière comme lézard sur la pierre